Si les médecins généralistes deviennent rares en France, c’est en partie à cause du sort que leur réserve notre système sanitaire. Mais d’où vient cet ostracisme, ce mépris pour une spécialité qui jouit pourtant d’une forte considération dans d’autres pays ? Je pense avoir trouvé un élément de réponse dans une revue professionnelle.
Pendant près de deux siècles, la formation des médecins français est restée très élitiste. Le concours de l’internat permettait à une petite moitié des médecins d’accéder à une formation pratique de haute qualité.
Parmi ceux qui échouaient à ce concours ou ne désiraient pas bachoter pour le préparer, certains se formaient tout de même à une spécialité par un laborieux certificat d’études spéciales (CES). Les autres étaient destinés à la médecine générale qui ne disposait ni d’une formation spécifique, ni d’un statut de spécialité.
Il y a 20 ans, cette séparation a disparu. Puis la médecine générale est devenue une spécialité à part entière, disposant d’un troisième cycle d’une durée de trois ans. Cette évolution était logique car cette médecine de premier recours, globale, systémique et sociale nécessite une formation spécifique, tant les missons du généraliste sont complexes et variées.
Parmi les médecins formés par l’internat, il existait l’élite parmi l’élite : les Anciens Internes des Hôpitaux de Paris (AIHP). Ils avait réussi le concours le plus difficile et en concevaient, à juste titre, une certaine fierté.
Ces AIHP ont fourni la quasi-totalité des "patrons" de médecine parisiens actuellement en exercice. Ces mêmes patrons sont parfois devenus des hommes politiques ou des personnages influents. Je crois pouvoir affirmer que plus de 90% des médecins conseillers des ministres de la santé et des titulaires de postes élevés dans la hiérarchie sanitaire sont des AIHP.
Ce système de caste n’est pas spécifique à la santé, on le retrouve pour les grandes écoles d’ingénieurs dans les grands corps d’état.
Toujours est-il que ces AHIP constituent un groupe soudé et solidaire, au point d’entretenir une association très active pour soutenir ses membres et défendre un titre et la mémoire d’un concours qui a perdu beaucoup de son sens depuis la réforme de l’internat.
Cette association est l’Amicale des Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Paris. Mon but n’est pas de critiquer le principe d’une entraide entre confrères ni la nostalgie d’une institution qui nous a donné beaucoup de nos plus grands médecins formé par le compagnonnage au lit du patient.

Ce qui me gêne, et qui motive ce billet, c’est ce qui est publié dans le bulletin interne de cette association, notamment sous la plume de son président : Emmanuel Chartier-Kastler.
Les éditoriaux de ce chirurgien urologue contiennent des charges odieuses contre les médecins généralistes. Le mépris exprimé par le président de l’AAIHP pour ma spécialité me paraît inquiétant, dans une revue diffusée auprès de tous les AIHP adhérents à son association, et donc auprès d’une majorité de médecins influents dans les hautes sphères politiques et sanitaires.
Voici ce qu’il écrit dans un éditorial en 2010 [1]

Extrait :
L’université à juste titre ne veut plus assumer les coûts de formation par cette voie dévolue à l’origine à des collègues à vocation universitaire ou à des spécialités nécessitant une formation plus spécifique, technique, longue et d’expérience telle la chirurgie par exemple."
Hum... Les intouchables débarquent dans les chasses gardées des castes supérieures. Cette formation universitaire de haut niveau, pour les futurs généralistes, serait donc de la confiture donnée aux cochons ?
Le propos est confirmé plus loin dans ce même éditorial :
Une fois de plus on sacrifierait un statut plus spécifique
pour les spécialités médico-chirurgicales hors médecine générale (CCA) pour satisfaire un lobby MG qui ne supporte pas la différence nécessaire de formation et d’exercice"
En bref : arrêtez de dévoyer au bénéfice de la médecine générale de précieux postes universitaires qui doivent être réservés aux "vraies spécialités". Passons sur l’absence de logique qu’il y a aurait à former à l’hôpital des médecins qui exerceront en ville.
Emmanuel Chartier-Kastler n’a pas compris que le concours a évolué, et que parmi les nouveaux médecins généralistes se trouvent des étudiants classés parmi les 100 premiers de l’examen national de fin d’études qui a remplacé l’ancien concours de l’internat. Il vit dans le souvenir des années 70-80, époque où les généralistes étaient privés de filière universitaire.
Son rejet du statut de spécialité pour la médecine générale transparaît dans un autre éditorial de 2011 qui se passe de commentaire.
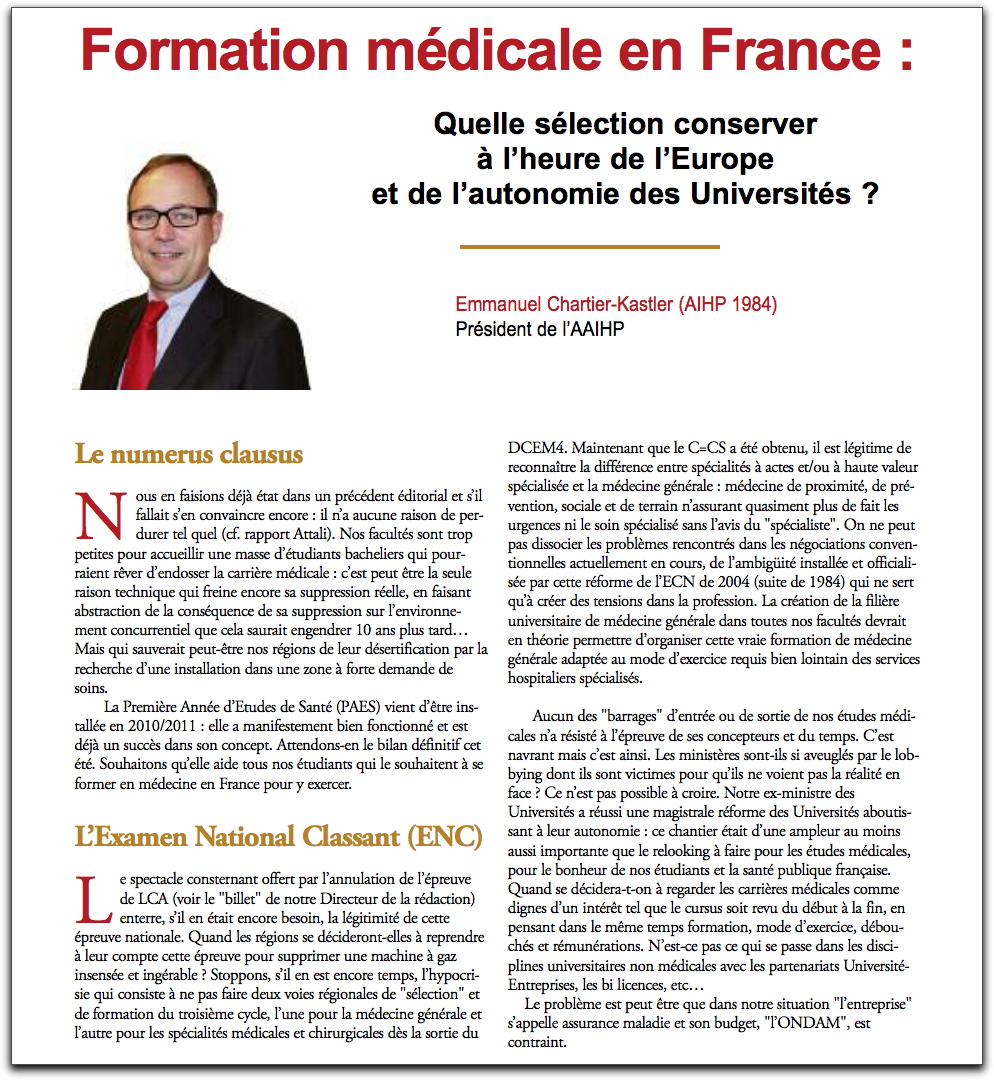
Extrait :
Maintenant que le C=CS a été obtenu, il est légitime de
reconnaître la différence entre spécialités à actes et/ou à haute valeur spécialisée et la médecine générale : médecine de proximité, de prévention, sociale et de terrain n’assurant quasiment plus de fait les urgences ni le soin spécialisé sans l’avis du "spécialiste". "
Mais la charge la plus violente est contenue dans une "tribune libre", publiée elle aussi en 2011 dans le même bulletin.

Extrait :
Comment ose-t-on faire croire que l’exercice de la médecine générale de ville puisse être compatible avec une vocation d’enseignant chercheur similaire à celle dévolue au statut des Hospitalo-Universitaires ? Ne serait-il tout simplement pas temps de séparer les missions et les titres et d’arrêter d’abaisser la valeur du titre de ceux qui le méritent par une confusion médiocre de banalisation généralisée. "
Ouch... Je me suis demandé si le statut de "Tribune libre" pour cette diatribe nauséabonde ne traduisait pas un certain malaise au sein du bureau de l’association.
Enfin le dernier éditorial paru récemment ne dépare pas le paysage :

Extrait :
(...)
"Souhaitons que nos Académies (Médecine et Chirurgie) puissent s’emparer de ce sujet pour le porter avec le recul et la sagesse qui les caractérise dans le même temps où il est de notre devoir de porter haut et fort l’étendard de la reconnaissance nécessaire pour ces activités techniques à haute valeur ajoutée."
Voici donc ce qui est donné à lire aux élites proches du pouvoir. Voila en partie pourquoi les généralistes sont privés des filières universitaires qui leurs permettraient d’accéder à une vraie reconnaissance, à une vraie recherche, et à un exercice valorisé susceptible d’attirer les jeunes confrères.
Tant que ce type de discours prévaudra dans l’entourage des ministres et des décideurs de la santé, une médecine générale de qualité et attractive ne pourra pas se développer en France. Le cercle vicieux perdurera : pas de postes universitaires -> pas de valorisation des élites -> désintérêt des étudiants pour la MG -> pas de recherche -> justification du refus des postes universitaires.
C’est odieux, stupide, coûteux pour la collectivité, et en total décalage avec ce qui se pratique dans d’autres pays.
Honte à mon confrère, honte à ceux qui ne l’ont pas fait taire !
Post-Scriptum du 11 mai
Pour faire suite à quelques réactions privées, je voudrais préciser certains éléments
Ce billet n’est pas destiné à alimenter je ne sais quelle guerre entre spécialistes hospitaliers et généralistes de ville, bien au contraire. Une médecine forte et efficace au service du patient suppose d’unir les efforts de tous vers des soins de qualité. Et c’est justement dans cet objectif que je réclame une filière universitaire d’excellence pour la médecine générale, filière dont nous ne serions pas dignes d’après Emmanuel Chartier-Kastler.
Dans le même esprit, je regrette la ségrégation universitaire que réclame mon confrère urologue, alors que nous devons au contraire travailler de concert pour converger vers l’excellence.
On aura compris que je ne suis en rien opposé à un élitisme universitaire qui permet aux meilleurs de se consacrer à l’enseignement et à la recherche.
Ce que je stigmatise dans ce billet, c’est un discours rétrograde, un comportement de citadelle assiégée, une fermeture sur l’autre et sur l’avenir. Bref, ce que l’on appelle généralement un corporatisme réactionnaire.
Notes
[1] Pour une meilleure lisibilité des documents, consultez la version imprimable de l’article.