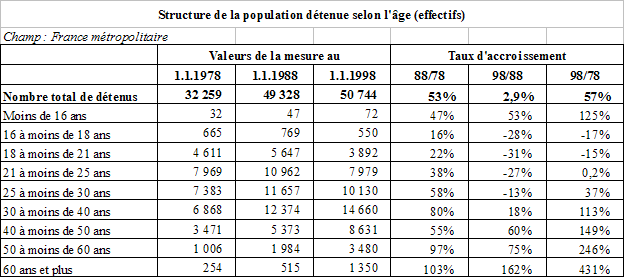Bonsoir et Bonne nuit Prisons : une humiliation pour la République
HYEST (Jean-Jacques), Président ; CABANEL (Guy-Pierre), Rapporteur
RAPPORT 449, Tome 1 (1999-2000) - commission d'enquête
-> Le rapport déclencheur
Quelques extraits
Source:http://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-449_mono.html#toc107
*******************************************************
c) Les malades mentaux : vers la prison-asile
Les " malades mentaux " représentent aujourd'hui près de 30 % de la population carcérale : une telle proportion s'explique principalement par une réforme du code pénal et par une évolution inquiétante de la psychiatrie en France.
(1) La révolution psychiatrique
La situation des " asiles " français, jusqu'à une date récente, était celle de l'Enfer de Dante : camisoles de force, cris des enfermés, phénomènes fréquents de maltraitance étaient le lot quotidien des hôpitaux psychiatriques.
Depuis vingt-cinq ans, une véritable révolution s'est opérée : le credo de la psychiatrie moderne est désormais " d'ouvrir " les hôpitaux psychiatriques.
Les possibilités offertes par les traitements chimiques, la chimiothérapie (psychotropes, anxiolytiques, lithium, antidépresseurs) et la psychothérapie ont permis d'améliorer de manière très importante les soins dispensés. Un malade suivant une chimiothérapie n'est plus considéré comme " dangereux " : il est ainsi mis " en liberté " ... ce qui permet de fermer un lit d'hospitalisation. Le " discours " psychiatrique a connu une révolution parallèle, le malade mental étant considéré comme étant un malade comme un autre.
En témoigne une déclaration du Conseil syndical des psychiatres des hôpitaux du 24 septembre 19749(*) : " Le terme même d'anormalité mentale fait référence à une conception caduque de l'aliénation ; il n'y a pas plus d'anormalité mentale qu'il n'y a d'anormalité cardiaque ou gastrique. Il y a seulement des malades qui méritent d'être pris en charge, c'est-à-dire soignés.
" Ensuite, il faut rappeler que le phénomène de délinquance est un phénomène second, qui n'est pas lié ontologiquement à l'état de santé mentale du délinquant. Il ne saurait donc être question de bâtir une conception des soins et des systèmes thérapeutiques à partir d'une conduite de délinquance.
" Enfin, il est un fait que les soins psychiatriques sont donnés dans des services de soins situés dans le cadre de l'hospitalisation publique ou privée et dans celui des institutions extra-hospitalières qui y sont annexées.
" Il ne saurait donc être question d'y modifier fondamentalement la qualité des rapports contractuels qui s'établissent entre les soignants et les soignés, en introduisant des considérations de restrictions des libertés des uns comme des autres. S'il existe un problème de délinquants anormaux mentaux, dont il est compréhensible qu'ils puissent avoir des difficultés à séjourner dans les services pénitentiaires courants, il appartient à l'administration pénitentiaire d'adapter ses propres services à sa propre clientèle. "
(2) Les psychiatres en prison
Les psychiatres jouent aujourd'hui un rôle considérable dans le système judiciaire et pénitentiaire : ils peuvent établir l'irresponsabilité de l'accusé ; une fois emprisonné, ils donnent différents avis sur les placements en quartier disciplinaire et sur les hospitalisations d'office.
Ce rôle essentiel est pour le moins paradoxal, puisque la " délinquance ", en tant que telle, ne semble pas les intéresser.
" Le psychiatre n'a pas pour vocation de traiter la délinquance. Même si des déterminants psycho-sociologiques ou culturels sont en cause, elle résulte d'un choix au sens sartrien du terme. Elle relève de la sphère privée au même titre que le choix religieux, politique ou sexuel. (...) Un psychiatre ne saurait accepter de prendre quelqu'un en charge thérapeutique pour sa délinquance ".10(*)
Par ailleurs, certains psychiatres avouent très clairement les limites de leur spécialité :
" La psychiatrie, dès qu'elle se trouve sollicitée, non plus de donner un avis sur l'éventualité de l'état de démence au temps de l'action ou sur la présence d'une pathologie mentale précise et avérée, mais de rendre compte d'une grande partie des conduites d'infraction, se retrouve devant un dilemme. Ou bien elle mesure lucidement les limites de son savoir et aussi de son savoir-faire, mais au prix de décevoir une demande à certains égards légitime et de laisser sans réponse des questions graves, faute d'explications rationnelles fondées sur des connaissances effectives ; ou bien elle dépasse ce qu'elle sait, allant vers un usage sans critique de l'analogie et de l'à-peu-près, c'est-à-dire, au bout du compte, vers un croire savoir et faire croire que l'on sait infiniment préjudiciable à la vérité et à la déontologie. "11(*).
La commission a pu constater que ce discours théorique était confirmé, chaque jour, par la pluralité des diagnostics des psychiatres, à propos du même patient : on lui a indiqué dans la " prison-asile " de Château-Thierry, qu'un détenu avait fait l'objet de quatre avis psychiatriques successifs et différents.
(3) La révolution pénale
La loi du 19 juillet 1993 a profondément modifié le code pénal et, notamment, l'ancien article 6412(*) qui permettait d'exonérer les malades mentaux de leur responsabilité pénale. L'ambiguïté de la notion de " démence " pouvait permettre toutes les interprétations. Les victimes, ou les familles des victimes, s'estimaient " privées " d'un procès et les prévenus bénéficiant de cette irresponsabilité pouvaient se retrouver, au bout de quelques mois, à nouveau libres de leurs actes.
Un consensus s'est naturellement dégagé sur la nécessité de réformer l'article 64. L'article 122-1 du nouveau code pénal distingue les personnes dont le trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement, qui ne sont pas pénalement responsables, et celles dont le trouble a altéré le discernement. Cette rédaction permet, contrairement à celle de 1810, de distinguer les " fous " des " demi-fous ".
Article 122-1 du nouveau code pénal
" N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
" La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. "
La dernière phrase du second alinéa de cet article pourrait laisser entendre que le juge est incité à diminuer la peine, en accordant des circonstances atténuantes. En fait, certaines juridictions y ont vu l'opportunité d'appliquer une peine plus lourde.
La commission tient à rappeler que le Sénat, lors de la discussion du code pénal, avait proposé une solution différente, selon laquelle la juridiction pourrait décider que la peine serait exécutée dans un établissement pénitentiaire spécialisé doté de services médico-psychologiques et psychiatriques appropriés.
Les psychiatres, s'appuyant sur le deuxième alinéa de l'article 122-1 du nouveau code pénal, ont interprété la loi dans un sens univoque. A leur sens, peu de troubles psychiques ou neuropsychiques abolissent le discernement de la personne ou entravent le contrôle de leurs actes. En conséquence, le nombre d'accusés jugés " irresponsables au moment des faits " est passé de 17 % au début des années 80 à 0,17 % pour l'année 1997.
Lorsque l'irresponsabilité est prononcée, le juge d'instruction est amené à se dessaisir en rendant une ordonnance de non lieu, le tribunal correctionnel prend une décision de relaxe et la cour d'assises doit prononcer un acquittement. L'infraction commise doit donc être oubliée ; elle n'a été qu'un révélateur de la maladie de son auteur. Mais ses troubles psychiques graves subsistent.
Il convient cependant de rappeler qu'une procédure quasi systématique d'information du préfet par les autorités judiciaires compétentes permet, au titre de l'article L. 348 de la santé publique (loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux), de placer l'auteur de l'infraction en hôpital psychiatrique.
Certains psychiatres souhaitent que l'on déclare le plus tard possible l'irresponsabilité dans le cours de la procédure judiciaire, cette dernière ayant une " valeur thérapeutique ". Un certain consensus existe -semble-t-il- sur le fait qu'il ne faille pas déclarer l'irresponsabilité : " la responsabilisation du malade dans la démarche de soins est difficilement compatible avec une irresponsabilité totale sur le plan pénal "13(*).
Les experts psychiatres sont ainsi tentés de ne pas déclarer irresponsables des personnes qui seront difficiles à gérer en hôpitaux psychiatriques : dernier maillon de la chaîne, les prisons sont là pour accueillir les malades mentaux !
(4) Les fous détenus et les détenus fous
Le ministère de l'emploi et de la solidarité évalue à 10 % le nombre de malades mentaux en prison ; ce pourcentage est apparu à la commission très en deçà de la réalité.
Les spécialistes s'accordent en effet sur le chiffre de 30 % de détenus souffrant soit de troubles psychiques à leur entrée de détention, soit de troubles s'étant révélés au cours de leur détention. Cette estimation a été confirmée par les interlocuteurs de la commission.
Afin de répondre à cette situation, le système pénitentiaire s'est doté, dès 1986, de services médico-psychologiques régionaux. Il en existe aujourd'hui 26 en France pour 187 établissements. Dans la pratique, ces SMPR ne sont pas en nombre suffisant pour " gérer " la maladie mentale en détention.
L'augmentation du nombre de détenus nécessitant l'application de l'article D. 398 du code de procédure pénale est un signe de cette évolution. En effet, cet article permet aux établissements pénitentiaires de procéder à des hospitalisations d'office dans les hôpitaux psychiatriques.
Les unités pour malades difficiles (UMD) de Montfavet, Villejuif, Sarreguemines et Cadillac ne comptent qu'un peu plus de 400 places, le nombre de leurs lits étant d'ailleurs en diminution.
Ce chiffre de 400 places ne doit d'ailleurs pas abuser : loin d'être réservées aux malades provenant des lieux de détention, elles sont appelées à recevoir l'ensemble des personnes, placées en hôpital psychiatrique, dont le comportement est considéré comme dangereux.
Le placement d'un détenu en UMD nécessite donc de longs délais, les hôpitaux spécialisés disposant par ailleurs de très peu de places en " milieu fermé ".
On peut comprendre que les juges ne soient pas tentés d'infléchir la pratique des psychiatres, la mise en liberté de fous dangereux étant particulièrement difficile à admettre pour l'opinion. La fin des asiles traditionnels laisse aussi de côté les malades mentaux errants ou en situation de précarité, qui suivent leur traitement de manière tout à fait hasardeuse.
(5) Un retour à la prison de l'ancien régime
La solution du " moindre mal ", celle de l'incarcération des psychotiques, est ainsi retenue, pour le plus grand malheur de l'administration pénitentiaire.
La gestion de ces malades en détention est une lourde charge. Ils nécessitent, par nature, beaucoup plus d'attention, d'écoute, et de soins.
En raison d'une dérive psychiatrique et judiciaire, des milliers de détenus atteints de troubles psychiatriques errent ainsi sur le territoire national, ballottés entre les établissements pénitentiaires, leurs quartiers disciplinaires, les SMPR, les UMD, les unités fermées des hôpitaux pénitentiaires... Le tout sans aucune cohérence.
Paradoxe terrible, la réforme du code pénal et la nouvelle " pratique " des psychiatres ont abouti à un résultat inattendu : de plus en plus de malades mentaux sont aujourd'hui incarcérés. La boucle est bouclée : la prison, aujourd'hui en France, est en train de retrouver son visage antérieur au code pénal napoléonien.
d) Les détenus âgés : vers la prison-hospice
En raison de l'allongement de la durée des peines et de la modification de la structure de la population carcérale selon les infractions, les détenus sont de plus en plus vieux. Le tableau ci-après en témoigne :
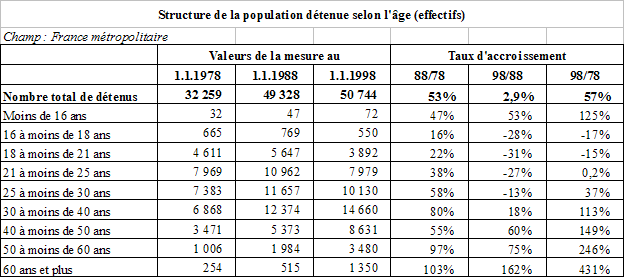
En vingt ans, alors que la population carcérale âgée de 16 à 25 ans a diminué, le nombre de détenus âgés de 30 à 40 ans a plus que doublé tandis que celui des plus de 60 ans a été multiplié par cinq.
Alors qu'en 1978, les détenus de plus de 40 ans représentaient seulement 14,6 % de la population carcérale, ils en constituent aujourd'hui 26,5 %.
Or, le vieillissement de la population carcérale n'est pas sans poser des problèmes à l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, 337 détenus sont septuagénaires et 22 octogénaires. Parmi eux, certains sont physiquement dépendants, alors même que les établissements pénitentiaires ne sont pas équipés pour accueillir une telle population. Non seulement les cellules ne sont pas adaptées, mais l'architecture des prisons n'a pas été conçue pour des personnes invalides. Ainsi, il n'existe pas d'ascenseur et les distances à parcourir pour accéder aux cours de promenades, aux parloirs ou encore aux unités de soins sont souvent importantes.
Par ailleurs, dans les établissements spécialisés pour les personnes dépendantes, ces dernières bénéficient d'un personnel formé qui assure leurs soins. En prison, les détenus dépendants, impotents ou incontinents doivent se débrouiller tous seuls. Souvent, ils ne sortent plus de leurs cellules et leur hygiène peut s'avérer très précaire.
Enfin, il ne faut pas sous-estimer leur isolement familial et social, surtout lorsqu'ils purgent de longues peines. Une enquête menée auprès des directeurs de prison a permis de constater qu'à partir de 7 ou 8 ans d'emprisonnement, les familles ne se manifestent plus régulièrement. Devenus complètement dépendants de l'administration pénitentiaire, certains sont incapables d'imaginer une vie en dehors de la prison. A la maison centrale de Clairvaux, la commission d'enquête a rencontré un détenu âgé de 72 ans qui refuse de partir pour une maison de retraite, alors même qu'il pourrait bénéficier d'une remise de peine.
**************************************************************
2. Les violences contre soi et contre les autres
Certes, incarcérer des personnes contre leur gré est en soi une situation " violente ".
Pour autant, les manifestations de cette violence, les violences contre soi, les violences contre les autres, ne sont pas une fatalité, et découlent directement de la surpopulation carcérale.
La commission d'enquête a pu se rendre compte, tant lors de ses déplacements sur le terrain que par les réponses apportées au questionnaire envoyé aux 187 établissements pénitentiaires, que les manifestations de cette violence se concentraient principalement dans les maisons d'arrêt, et que la situation de ces établissements était loin d'être identique à cet égard.
a) Les manifestations de la désespérance : les suicides, les automutilations, les grèves de la faim
(1) La prison suicidaire
Le " taux " de suicides en prison est sept fois plus élevé en prison qu'à l'extérieur. Il reste que cette statistique appelle une réserve, en l'absence de comparaison du nombre de suicides en prison et du nombre de suicides dans la population " la plus susceptible d'aller en prison ", mais en situation de liberté. La forte présence de malades mentaux dans les établissements pénitentiaires peut expliquer, pour une part, l'augmentation importante du nombre de suicides sur la période 1990-2000.
A partir de 1992, le nombre de détenus décédés à la suite d'un acte suicidaire a augmenté dans des proportions inquiétantes
Deux " moments " sont propices au suicide : les premières semaines de la détention (40 % des suicides interviennent dans les trois mois qui suivent l'incarcération, dont plus de la moitié dans les quinze premiers jours40(*)) et les périodes de placement en quartier disciplinaire.
Par ailleurs, le nombre de tentatives de suicide est élevé : 1.006 en 1998, dont 34,4 % par pendaison.
Le Garde des sceaux a engagé une politique de prévention du suicide en milieu carcéral, en constituant un groupe de travail en 1996, et en définissant un plan d'action en janvier 1997.
Une circulaire a été publiée en mai 1998, rappelant les dispositions réglementaires et un programme expérimental a été mis en oeuvre dans onze sites pilotes : tentative d'identification des " sujets à risques " lors de la visite d'entrée et observation plus attentive des personnes détenues considérées comme plus fragiles.
Il reste que bon nombre de suicides pourraient être évités si le personnel pénitentiaire pouvait consacrer davantage de temps à l'écoute des détenus. Les maisons d'arrêt " à taille humaine " visitées par votre commission d'enquête présentent des taux de suicide quasiment nuls : le Mans, Château-Thierry (malgré une " population " toute particulière), Melun, Alençon...
Un très grand nombre d'établissements, dans les réponses au questionnaire de la commission, ont déclaré une absence de suicide dans les dernières années.
Les grands établissements -en raison naturellement de l'effet taille- présentent des statistiques plus préoccupantes.
On remarquera également des mauvaises " séries ", par exemple les maisons d'arrêt de Rennes et d'Angers, malgré une population raisonnable (moins de 400 détenus).
La commission a constaté que la " communication " de l'administration pénitentiaire sur le sujet des suicides est le plus souvent déficiente ; la famille est prévenue de manière lapidaire, et de façon tardive. La contre-autopsie lui est fréquemment refusée. Confrontée à un drame, elle peut être amenée à " douter " de la réalité du suicide, ce qui nuit profondément à l'image de l'administration.
Il apparaît d'ailleurs probable qu'un certain nombre de suicides peut recouvrir une autre réalité, celle du meurtre entre codétenus.
(2) Les automutilations
Les automutilations apparaissent en prison à la fois comme une manifestation du désespoir des détenus et comme un moyen d'appeler au secours. Il suffit d'une lame de rasoir pour entailler un bras. Certains détenus exhibent avec fierté leur avant-bras, strié de marques indélébiles.
Votre commission a assisté, quasiment en direct, à une telle automutilation à la maison d'arrêt d'Alençon.
Le sectionnement de doigts et l'ingestion de corps étrangers (fourchettes) ou de produits toxiques sont fréquents. L'automutilation grave peut devenir, au gré des statistiques, une " tentative de suicide " : 139 des 1.006 tentatives de suicide étaient liées à des " automutilations graves " en 1998.
Le nombre d'automutilations n'est cependant pas connu avec précision. Selon M. Jean-Jacques Dupeyroux, il serait de l'ordre de 2.000 par an.
La commission avait posé des questions précises sur ce sujet à l'ensemble des établissements : il s'agissait de préciser le nombre de suicides intervenus depuis dix ans, d'en expliquer les circonstances et d'indiquer l'heure approximative. En ce qui concerne les automutilations, il était demandé d'en retracer l'évolution depuis dix ans.
Les réponses fournies par les établissements manquent le plus souvent de précision. Des établissements sont incapables de chiffrer les automutilations et certains comptent les grèves de la faim dans les automutilations. D'autres enfin classent les tentatives de suicide dans les automutilations.
Le centre de détention de Muret se distingue tout particulièrement, en affirmant son " impossibilité de fournir les éléments de réponse ".
L'imprécision de ces réponses appelle une réserve importante sur la qualité des statistiques de l'administration pénitentiaire, et des conditions dans lesquelles s'effectue aujourd'hui l'agrégation des éléments recueillis dans les 187 établissements pénitentiaires.
Votre commission estime souhaitable que la Direction de l'administration pénitentiaire appelle l'attention des établissements sur la nécessité de disposer de statistiques fiables et actualisées : un directeur d'établissement ne doit pas seulement être jugé en fonction du taux d'évasion (phénomène d'ailleurs quasiment nul en maison d'arrêt), le taux de suicide étant un élément déterminant de l'évaluation d'un établissement pénitentiaire.
(3) Les grèves de la faim... et de la soif
La statistique de l'administration pénitentiaire ne reflète pas la réalité en ce domaine : ne font l'objet d'une signalisation à l'administration centrale que les grèves de la faim d'une durée supérieure à 7 jours ou qui s'accompagnent d'une grève de la soif.
Ces manifestations, même minorées, sont cependant en augmentation :
Dans la très grande majorité des cas, le refus de s'alimenter cesse au cours du premier mois (818 cas sur 953 en 1998) ; 13 détenus ont poursuivi, au cours de l'année 1998, leur grève de la faim au-delà de trois mois.
b) La conséquence de la promiscuité : la progression des agressions
L'une des missions essentielles de l'administration pénitentiaire est de veiller à la sécurité des personnes qui lui ont été confiées par la société. Aujourd'hui, en raison de la surpopulation, cette mission n'est pas correctement assurée dans les maisons d'arrêt françaises.
Deux types d'agressions peuvent être constatés en prison : les agressions contre les surveillants et les agressions entre détenus. Il faut malheureusement y ajouter le cas exceptionnel d'agressions de détenus par les surveillants.
(1) Les agressions contre les surveillants
Les agressions contre les surveillants font le plus souvent l'objet d'une répression systématique. Il suffit d'un mot lâché, d'un mouvement d'épaule, d'un geste d'énervement d'un détenu pour que celui-ci passe devant la commission de discipline, le " prétoire " de la prison.
Elles sont en forte augmentation : le rapport 1998 de l'administration pénitentiaire fait état de 278 agressions contre les membres du personnel (215 agressions en 1997), dont 184 ont entraîné une interruption totale de travail d'au moins un jour.
(2) Les agressions entre détenus
En revanche, les agressions entre détenus sont mal connues : racket, coups et blessures, viols,...
Le racket semble malheureusement être une réalité de tous les jours. Même si le " caïdat " traditionnel n'existe plus, le phénomène de bandes se reconstitue. Le racket est un moyen d'échapper au travail, jugé dégradant, et de continuer à assurer son autorité, au-delà même des murs de la prison.
Les détenus les plus fragiles, les plus isolés, les plus démunis quémandent un peu de cantine en échange du nettoyage de la cellule.
Un détenu victime d'une agression préfère nier, même si celle-ci a été " repérée " par les surveillants. En effet, un " mouchard " risque de subir des représailles très graves. Même si l'agresseur est séparé de l'agressé, l'administration pénitentiaire ne peut promettre au second, qu'au hasard des transferts entre maisons d'arrêts et centres pénitentiaires, il ne retombera pas sur le premier. De plus, le " téléphone arabe " de la prison fera du dénonciateur un exclu, qui devra être placé, jusqu'à la fin de sa détention, en quartier d'isolement.
Les agressions sexuelles se déroulent à la fois en cellule et dans les douches collectives. Un détenu peut être contraint à des relations sexuelles, soit par la menace, soit par le chantage.
La commission a pu constater que le " tabou " des relations sexuelles en prison semblait en passe d'être levé, comme le montre la distribution de préservatifs à l'entrée des UCSA. Ce tabou ne s'explique pas seulement par la pudeur de l'administration pénitentiaire ; il est difficile à une population masculine présentant un discours fortement " machiste ", niant l'évidence avec l'énergie du désespoir (" On n'est pas des gonzesses ou des pédés ! ") et affichant aux murs de sa cellule des posters de revues érotiques oscillant entre le soft et le hard, de reconnaître qu'elle se livre nolens volens à des pratiques homosexuelles.
Les douches collectives nécessitent une gestion " lourde " de personnels et posent de graves problèmes de sécurité. Le surveillant reste à l'extérieur des cabines, en vue d'un autre surveillant susceptible de lui prêter secours et d'appeler du renfort.
Dans la pratique, les surveillants peuvent être conduits, par lassitude et résignation, à " fermer les yeux " sur les règlements de comptes.
Il reste que, le plus souvent, ces incidents ont lieu en leur absence ; dès lors, le surveillant est la personne la mieux à même de repérer le détenu qui ne se lève pas, qui mange peu, qui ne rejoint pas les autres à la promenade : son isolement est alors incontournable.
(3) Les violences exercées par les personnels contre les détenus
Les violences exercées contre les détenus par les surveillants sont un phénomène exceptionnel.
Comme l'a indiqué M. Ivan Zakine devant la commission, " les critiques sont rarissimes à l'égard du comportement des agents de l'administration pénitentiaire. Il n'en va pas de même à l'égard des services de police. Cela s'explique notamment par le fait que les agents de l'administration pénitentiaire vivent longtemps leur relation avec les détenus. Par conséquent, ils ne peuvent pas impunément se comporter brutalement à l'égard de quelqu'un qu'ils côtoieront souvent pendant de longues années. "
Mais, comme le montre l'exemple de la maison d'arrêt de Beauvais, des comportements inadmissibles ne sont malheureusement pas exclus. Ces violences ne sont réprimées qu'avec beaucoup de retard par l'administration pénitentiaire. Un fort esprit de corps, le sentiment d'être incompris, poussent un bon nombre de surveillants, même s'ils désapprouvent les dérapages de la très petite minorité de " brebis galeuses ", à fermer les yeux.
Dans une administration très hiérarchisée, la loi du silence fait partie intégrante de la " culture pénitentiaire ". L'article 40 du code de procédure pénale, obligeant tout fonctionnaire à transmettre au procureur de la République les " renseignements, procès-verbaux et actes " relatifs à la connaissance d'un crime ou d'un délit, est parfois mal connu et encore plus rarement invoqué.
Cependant, tant le Garde des sceaux que la directrice de l'administration pénitentiaire ont insisté devant la commission sur le taux élevé de sanctions prises à l'égard du personnel : 260 pour 26.000 personnes. Plusieurs chefs d'établissement ont été discrètement suspendus et des cadres ont été rétrogradés.
*************************************************
Cordialement
Bien à vous.

 Envoyer ce sujet à un(e) ami(e)
Envoyer ce sujet à un(e) ami(e) Format d'impression
Format d'impression Mettre en signet (membres seulement)
Mettre en signet (membres seulement)
 Forum :
Santé Psy (Protected)
Forum :
Santé Psy (Protected)




 ...
...